Artiste talentueux à l’univers unique, Boris Robin est à la fois peintre, sculpteur, tatoueur, découpeur, colleur. Ce plasticien donne vie à des monstres tout en variant ses thèmes autour d’une richesse infinie. Rencontre !
Bonjour Boris. Nous connaissons ton travail sur des créatures et des personnages torturés, mais pas seulement. Depuis quand dessines-tu, et pourquoi avoir commencé ?
Boris – Quand j’étais gamin, j’étais fan d’Heroïc Fantasy, de figurines fantastiques, de cartes Magic, de cinéma, de marionnettes, de sculptures et de graffitis. J’ai étudié les grands graffeurs et peintres, j’ai été influencé par le mouvement des Enfants Terribles.
J’ai commencé avec du modélisme, puis de la peinture. J’ai beaucoup aimé peindre sur des volumes à travers la figurine, et l’étude des backgrounds qu’il y avait derrière. Ma mère était illustratrice à l’époque, je trouvais son travail vraiment trop bien, j’avais envie de l’imiter car elle était vraiment très forte.
Mon travail est un mélange d’horreur et de baroque, avec une inspiration Caravage pour les lumières. J’adore les affiches psychédéliques, la culture du jeu vidéo…
Nous apprenons dans ta biographie ton passage par une école d’art, et ton parcours hétéroclite. Quels enseignements en as-tu tiré ?
Ensuite j’ai eu un boulot dans les sextoys, pour une boîte qui travaillait entre la France et l’Allemagne. J’ai appris à sculpter les parties intimes. Ce fut très intéressant d’étudier le corps des femmes notamment, c’est compliqué car tout est dans la subtilité. Après avoir travaillé dans le jeu de rôle, j’ai toujours surfé entre les genres : fanzines, affiches, commandes… Des difficultés sont apparues avec une maladie, rare et qui joue sur ma bipolarité. J’ai dû quitter les études très tôt.
En invoquant l’art dans le milieu urbain, que souhaites-tu créer ?
Boris – J’aime le collage et le street art, même si ce dernier a subit un développement superficiel, à partir du moment où il s’est démocratisé en masse. Mes affiches et graffs sont donc un moyen de faire une caricature, je les colle rapidement, ça apporte un sentiment de vie. J’aime également tromper l’ennui, c’est à dire me demander en me levant le matin ce que je vais pouvoir faire de nouveau, que je n’ai encore jamais fait.
Cette pratique se fonde avec des risques. Comment cela se passe avec les autorités ?
Boris – Cela dépend. Je viens d’écoper d’heures de travail d’intérêt général, et nous avons eu des procès. Nous avons travaillé sur des lieux qu’on nous avait indiqué comme autorisé. J’ai eu des problèmes également car des personnes ont collé des affiches de poisson partout. Parfois les policiers n’hésitent pas employer le violence (et même les chiens), alors que d’autres sont sympas et viennent discuter avec nous. Récemment nous avons dessiné sur le mur d’une vieille décharge abandonnée, cela est encore considéré comme vandale, mais tout s’est bien passé, nous avons échangé avec les autorités sans problèmes. Faire d’une décharge quelque chose de beau, c’était notre seule volonté.
Le soucis c’est que le graffiti coûte cher aux villes, certains en font sur les Eglises ou à l’acide sur des vitrines, à ce moment là tu n’effaces plus rien. Le vrai graffiti est contraire à l’image de la société. Aujourd’hui les vandales se sentent libres, c’est pour eux une façon de dire qu’ils existent, de faire leur petite révolution, mais artistiquement cela tourne en boucle. Personnellement je suis intéressé par les oeuvres psychédéliques des années 70.
Tu déploies une grande imagination dans tes dessins. Qu’est-ce qui t’animes lors d’une création ?
Boris – L’art permet de passer au dessus de pas mal de souffrances, sinon je tourne en boucle. J’ai une manie à être obsessionnel compulsif, mais je ne suis pas le seul, c’est le cas chez beaucoup de peintres. J’ai une démarche d’artisan qui me conduit à l’art, je me cherche moi-même. L’une des choses que je préfère est également de travailler avec des gens, de concilier nos styles, nos manières.
Quand je suis dans une phase positive, je commence plein de projets, je suis ultra-rapide et dessine sans le soucis de terminer. En revanche en période dépressive, j’ai tendance à finir mes projets, qui concluent alors sur des rendus plutôt glauques. Je suis capable de dessiner trois jours d’affilé dans une phase de manie aiguë. Je possède en moi cette bipolarité. On pourrait la résumer avec cette image que m’a partagé un ami : c’est comme si tu voulais faire Paris-Brest en voiture, mais que tu passais par Lyon.
Mais je vis aussi de l’espoir. L’art, c’est créer des ruptures et du dynamisme dans la vie, un nouveau souffle.
De quelles idées sont nourries tes illustrations ?
Boris – J’aime la peinture vibrée, le langage du mouvement, et ainsi les peintres impressionnistes, le graphique, les ambiances glauques. J’aime par dessus tout étudier l’effondrement du réel.
Je suis modéliste et sculpteur avant d’être dessinateur. J’aime tuer le réalisme pour le rejoindre après, d’où mes bonshommes patates et protozoaires.
En peinture, comment agences-tu tes atmosphères ? Tu as une palette de couleurs juste incroyable…
Boris – Je suis plus coloriste que dessinateur. J’aime habiller de couleur mes dessins, les styles macabres me comblent. J’aime le réalisme car il est une façon de travestir quelque chose de vide. J’essaie de développer un vocabulaire graphique, de raconter un évènement dans une image. Parmi mes lacunes, il faudrait que je travaille mon noir et blanc en priorité.
Quelles sont les personnes qui t’inspirent dans ton travail ?
Boris – J’aime beaucoup l’univers de Robert Biss (connu pour avoir bossé sur la saga Harry Potter). Viennent ensuite les Simon Bisley, Mike Mignola, Ron Mueck. Dans la figurine, on était également toute une bande d’amis créatifs qui se rassemblaient, et s’inspiraient mutuellement. Mais notre trip c’était aussi le voyage, on ne faisait pas que ça, on souhaitais voir d’autres choses.
Sans oublier le peintre Rodzaz Zenski, un Polonais des années 70, qui avait une réelle structure de l’affiche, avec des représentations macabres. Et ce matin, j’ai été trop inspiré par le cimetière et les pentes de la croix-rousse, les maisons et leurs petits jardins.
Tu travailles également sur des Fanzines, et des expos-concerts.
Boris – Le fanzine «Bibendoom» eu un succès qui nous a dépassé, on a épuisé 320 exemplaires en 2 mois. C’était un vrai livre d’art, 120 artistes pour 120 pages. Le prochain portera sur la détresse psychique des créatifs. Cela m’offre de nombreux apprentissages, comme le travail sur logiciel, le maquettisme PAO, l’édition d’un livre… J’ai l’impression de faire actuellement des études, j’aime avancer en imaginant le projet parfait.
Avec notre collectif Tandax, nous sommes des passionnés de musique Noise, nous essayons de fixer des dates pour les groupes, leur réaliser des affiches.
En parlant de projets, en as-tu de nouveaux en vue ?
Boris – Je vais bientôt sculpter le poisson, en moulant un crâne de cheval et en le tirant avec des écailles multicolores de partout. Il fera dans les 2,50 mètres de long. J’écris également un livre «Désespoir d’un colleur d’affiche», qui analyse ma maladie dans ce que je fait.
Il ressort de ton travail de nombreuses études animales, avec des mélanges esthétiques et anatomiques. Que cherches-tu dans ces mutations ?
Boris – J’aime beaucoup l’anatomie comparée, pour apprendre comment fonctionnent les êtres vivants, se rendre compte de l’évolution des espèces. Ca m’est resté des figurinistes, qui sont très pointus et synthétiques. On comprend comment se subdivisent les volumes. J’adore dessiner des crabes par exemple ! Il faut un deuxième monde, car l’art c’est quelque part vaniteux, tu cours après quelque chose qui n’existe pas.
C’est positif de rater des projets, car tu sais après où il ne faut pas aller.
Ton travail s’appuie également sur une réflexion autour des hommes et leurs modes de vie. Comment perçoit-tu le sujet humain ?
Boris – Je bascule entre une hyper-misanthropie et un hyper-humanisme. J’aime vivre dans le moment présent, je ne vois pas pourquoi il faudrait faire des plans sur la comète. J’ai été élevé par mes grands parents, ce qui me laisse des valeurs des années 50. Une certaine discipline, telle qu’on la voit dans le sport, est nécessaire dans tous les domaines. On doit tous travailler, mais pas pour enrichir une société qui ne marche pas. Dans les squats, nous sommes liés : on s’influence les uns les autres, on se sent bien quand on se lève le matin. J’aime au fond l’esprit de révolte des jeunes, qui est très important.
Par ailleurs, je suis assez marqué par le double tranchant de l’Internet. Le Web fonctionne comme un véritable moteur, mais en même temps il porte des conséquences directes sur l’art. J’ai remarqué par exemple que la figurine existait de plus en plus par Internet, ce qui est inquiétant pour ce genre d’art qui peut facilement devenir pauvre. De façon générale les publics ne se déplacent plus sur les expositions pour apprécier les œuvres dans leur réalité. L’art deviens un produit de consommation immédiat, la rencontre disparaît.
Merci de nous avoir accordé ce moment !
Pour découvrir le travail de Boris Robin, direction sa page Internet.


















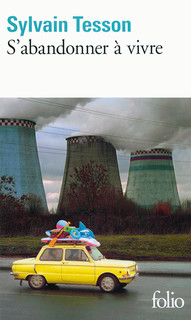

Pour avoir travailler il y a peu avec un graffeur sur le sujet de la réapropriation de l’espace public, j’ai trouvé ton article passionnant et le travail de Boris même si c’est pas mon style est plein de bonnes chose et de motivations.
Heureux que le contenu de cet entretien t’ait plu.
Zut, va falloir faire le poisson avant alors! ^^
C’est ce que je me suis dit ! Allez guillaume au boulot, j’en veux un encore plus gros, disons 5 mètres :)
Je ne connaissais pas cet artiste merci de nous l’avoir fait découvrir ;)
Merci pour ton message GiLel. Le travail de Boris Robin, son exigeance artisitique, et ce style si unique, procure une véritable explorations de mondes souterrains de la conscience. :)
Merci à Boris de m’avoir fait découvrir ce blog !
Salutations Père Gab, et bienvenue parmi nous :) j’espère que tu y trouveras des choses intéressanes, au plaisir d’échanger autour des arts et autres.